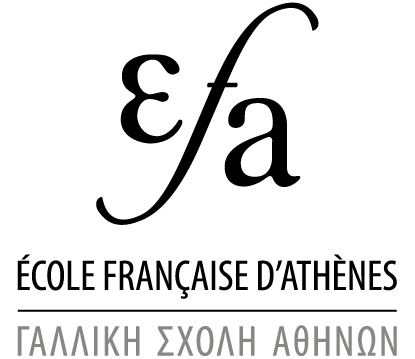Albanie- Apollonia
Apollonia d’Illyrie est l’une des principales cités fondées par Corinthe et Corcyre dans la seconde moitié du VIIe s. av. n. è. Avec Dyrrachion, elle était une étape importante dans les circulations maritimes entre la Grèce et les ports adriatiques et entre la péninsule italique et les Balkans. Située sur un promontoire à l’extrémité nord-ouest des collines qui forment le massif de la Mallakastër, Apollonia se trouvait à 5 km à vol d’oiseau de la mer, séparée d’elle par une lagune, et disposant également d’un accès fluvial.
La ville d’Apollonia eut, à son maximum, une superficie intra-muros de 85 hectares, où deux réseaux urbains d’orientation et de dimensions différentes occupaient deux zones topographiquement différenciées — la ville haute et la ville basse, séparées par un talus.
C’est de la ville haute que proviennent les plus anciennes traces d’occupation, qui remontent au VIIe s. av. n. è. Ce sont ensuite les sources littéraires, épigraphiques et numismatiques qui apportent des informations précieuses sur certaines périodes de l’histoire de la cité. De nombreux conflits éclatèrent d’abord entre Apollonia et ses voisins, au Ve s., puis contre les Macédoniens. Pyrrhus, roi d’Épire, s’empara de la cité autour de 275 et Apollonia profita ensuite d’alliances avec Rome et les Étoliens et cette situation au IIIe s. fut propice à de nombreux travaux dans la ville. Après les victoires romaines et apolloniates contre Philippe V (en 214, 211 et 205), la cité fut rattachée à la province de Macédoine et reçut la visite de grands hommes politiques romains au Ier s. av. n. è., avant d’obtenir le statut de civitas libera et immunis. La fin de l’histoire d’Apollonia est celle d’un abandon progressif, à la suite d’un grave tremblement de terre en 354 de n. è.
Plusieurs voyageurs passionnés d’antiquités visitèrent le site d’Apollonia, avant que les fouilles ne commencent en 1916-1918 sous la conduite de l’archéologue autrichien Camillo Praschniker.
De 1924 à 1939, l’archéologue français Léon Rey effectua les premiers grands travaux archéologiques, en mettant à profit son expérience acquise dans le Service archéologique de l’armée française en Orient et en Macédoine. Après des fouilles italiennes en 1941, une équipe albano-soviétique reprit l’exploration des principaux monuments de la ville à la fin des années 1950 et le site devint l’un des terrains de prédilection des archéologues de l’Institut archéologique de Tirana.
En 1992 commença une nouvelle collaboration entre l’Albanie et la France, dans le cadre de la mission épigraphique et archéologique fondée par Pierre Cabanes et Neritan Ceka et portée par l’Institut archéologique de Tirana et le ministère français des Affaires étrangères. De 1998 à 2016, elle fut dirigée par Jean-Luc Lamboley et par Bashkim Vrekaj, Shpresa Gjongecaj et Faïk Drini. Elle eut pour objectifs de constituer un corpus des inscriptions antiques de l’Albanie, d’élaborer un atlas archéologique et historique d’Apollonia d’Illyrie et de reprendre des fouilles dans la ville haute.
En 2018, l’accord de partenariat a été renouvelé entre l’Institut archéologique de l’Albanie et les institutions françaises parties prenantes du nouveau programme (le ministère des Affaires étrangères, les Écoles françaises d’Athènes et de Rome et plusieurs laboratoires de recherche français). Sous la direction, depuis 2017, de Stéphane Verger et Belisa Muka, le nouveau programme se consacre à l’achèvement des principales monographies sur les fouilles de 1994 à 2016, à la reprise des fouilles dans le secteur de la porte nord-ouest et au lancement de nouvelles études (en particulier sur le rempart et l’urbanisme).
Bibliographie
Les travaux effectués sur le site d’Apollonia font l’objet de rapports préliminaires qui ont paru régulièrement dans le Bulletin de correspondance hellénique (BCH – Persée), dans les Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité (MEFRA – Persée / OpenEdition) et dans la Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome (CEFR – OpenEdition).
Ils paraissent désormais dans le Bulletin archéologique des EFE (BAEFE – OpenEdition).
Quelques ouvrages de référence :
- Pierre Cabanes, Neritan Ceka, Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Epire. 1. Inscriptions d’Épidamne-Dyrrhachion et d’Apollonia. 2.A. Inscriptions d’Apollonia d’Illyrie. 2.B. Liste des noms de monétaires d’Apollonia et Épidamne-Dyrrhachion, Athènes, Fondation D. et É. Botzaris – École française d’Athènes, Études épigraphiques 2, 1997. Lire en ligne sur CEFAEL
- Vangjel Dimo, Philippe Lenhardt, François Quantin, Apollonia d’Illyrie. Tome 1, Atlas archéologique et historique, Athènes – Rome – Paris, École française d’Athènes – École française de Rome – Ministère des Affaires étrangères, Collection de l’École française de Rome 391, 2007. Lire en ligne sur TORROSSA
- Jean-Luc Lamboley, Faïk Drini, Stéphane Verger, François Quantin, Saimir Shpuza, Philippe Lenhardt, Vasil Bereti, Altin Skenderaj, « Apollonia d’Illyrie : nouvelles données sur l’urbanisme et l’histoire de la ville antique », DHA, 36.2, 2010, p. 165‑178. Lire en ligne sur PERSÉE
- Neritan Ceka, Apollonia. Histoire et monuments, Lamboley Jean-Luc, Quantin François (trad.), Tirana, Migjeni, 2008