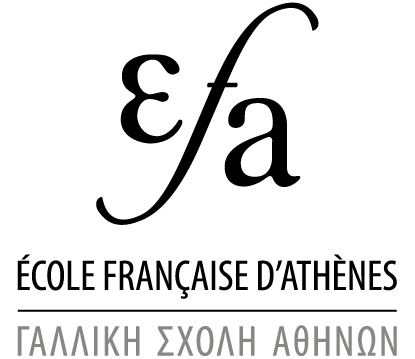Colloque international, 24-26 Septembre 2020
Ce retour massif d’une époque définitivement révolue a pu – à juste titre – être ressenti comme un poids accablant pour le présent d’une société au sein de laquelle il faudra cultiver activement les réminiscences antiques. Le hiatus créé entre la langue parlée (δημοτική) et la langue puriste (καθαρεύουσα) illustre bien l’emprise d’un passé monumental sur un présent voué à devenir archaïsant.
En même temps, un tel retour impliquait effectivement de réussir un exercice d’introduction et d’acclimatation de la tradition classique européenne et de ses savoir-faire disciplinaires.
Nous voudrions explorer ce retour du passé dans le présent en questionnant a. la diversité et l’hétérogénéité des « Antiquités » créées et véhiculées aux XIXe et XXe siècles, b. le contexte (national, culturel, politique) dans lequel les diverses, et souvent contradictoires, représentations de l’Antiquité ont été formulées en interférant les unes avec les autres, c. les manières dont le contexte dominant de l’histoire nationale a été consolidé ou sapé par d’autres cadres de pensée projetant sur l’Antiquité des demandes alternatives. Nous voudrions donc encourager une perspective interdisciplinaire impliquant le dialogue avec les études culturelles, les études de réception ou la théorie littéraire.

Nous avons défini dix axes de recherche dont les thématiques proposées sont bien entendu indicatives (et non pas exhaustives) :
-
Articuler le couple Anciens/Modernes : historiographie, temporalités, représentations, imaginaires
-
Une relation triangulaire : de la Grèce moderne à la Grèce ancienne via l’Europe
-
a. Introduire le savoir classique européen : traductions et politiques de la réception
b. Le voyage en Grèce (Itinéraires, pèlerinages, guides de voyages etc.)
c. Médiation et politique culturelles des écoles archéologiques « étrangères »
-
-
Les institutions grecques modernes et la promotion d’un savoir classique autochtone (?) : Société archéologique, Université d’Athènes, musées etc ; Histoire nationale et « laographie » (Volkskunde, Folklore)
-
L’Antiquité à l’épreuve des idéologies (19e – 20e s.)
-
L’Eglise orthodoxe chrétienne face à l’Antiquité Le « trop » d’Antiquité : critiques et satires de l’anticomanie néo-hellénique ; la discussion sur le kitsch
-
Revivalismes
-
a. Le parlêtre grec moderne ou l’insoluble question de la langue
b. Civilisation matérielle et Antiquité : nommer : prénoms, rues, plans de répression politique ou de prévention face aux catastrophes naturelles ; Construire: les architectures modernes ; Symboliser : pièces, médailles, timbres ; Fabriquer : les souvenirs ; Marquer : les tattoos ;
c. S’associer : les associations sportives et culturelles (les associations néo-païennes etc)
d. jeux vidéos, bandes dessinées, jeux de société
-
-
L’« autre » des anciens Grecs chez les Grecs Modernes : les Antiquités au-delà de l’Antiquité grecque (les civilisations romaine, juive, égyptienne, persane, etc)
-
Identités sexuées et Antiquité : les communautés LGBT ; le phénomène du homonationalism etc
L’Antiquité de la diaspora grecque : revues, associations, tavernes, écoles etc
Le colloque, se tiendra à la Fondation Hellénique de la Recherche Scientifique du 24 au 26 septembre 2020.
Comité d’organisation
Chryssanthi Avlami
Michalis Konaris
Sofia Matthaiou
Alexandra Sfoini
Comité scientifique
Chryssanthi Avlami, Université Panteion & ANHIMA
Constanze Güthenke, Université d’Oxford
Alexandra Lianeri, Université de Thessalonique
Paraskevas Matalas, Université de Crète
Marie-Elisabeth Mitsou, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
Ourania Polycandrioti, Fondation Hellénique de la Recherche Scientifique