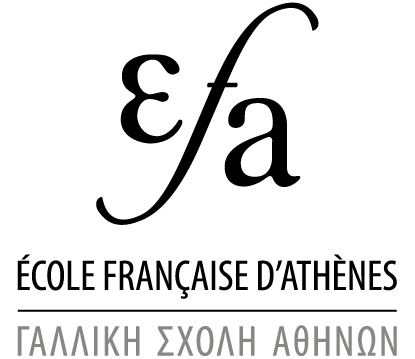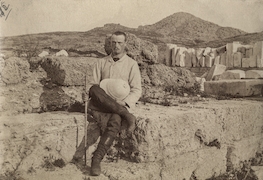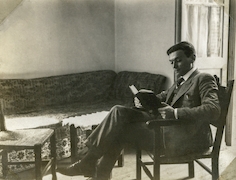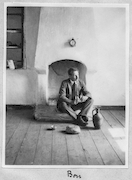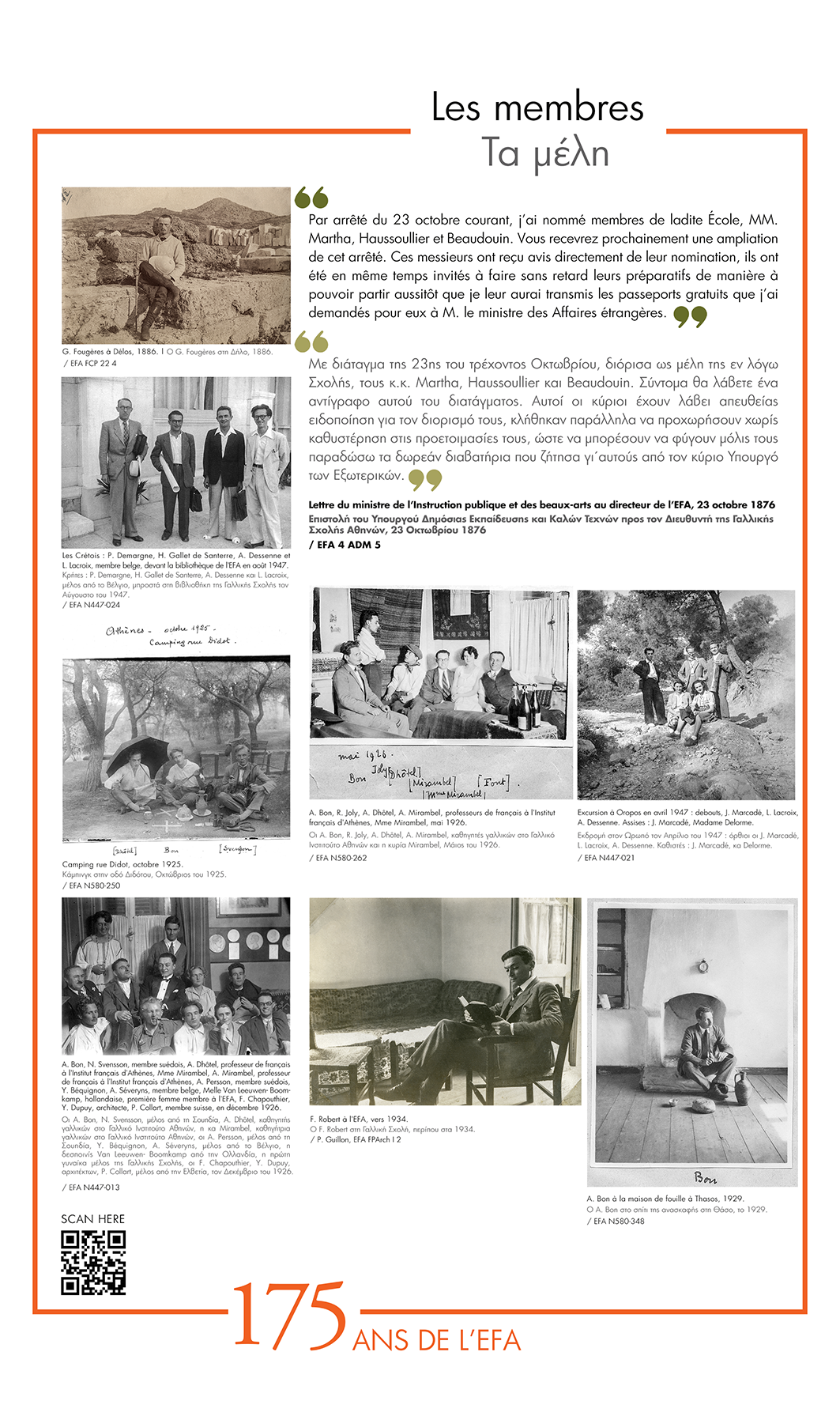 Lettre du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts au directeur de l’EFA, 23 octobre 1876 / EFA 4 ADM 5
Lettre du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts au directeur de l’EFA, 23 octobre 1876 / EFA 4 ADM 5
« Par arrêté du 23 octobre courant, j’ai nommé membres de ladite École, MM. Martha, Haussoullier et Beaudouin. Vous recevrez prochainement une ampliation de cet arrêté. Ces messieurs ont reçu avis directement de leur nomination, ils ont été en même temps invités à faire sans retard leur préparatifs de manière à pouvoir partir aussitôt que je leur aurai transmis les passeports gratuits que j’ai demandés pour eux à M. le Ministre des Affaires étrangères. »
Επιστολή του Υπουργού Δημόσιας Εκπαίδευσης και Καλών Τεχνών προς τον Διευθυντή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, 23 Οκτωβρίου 1876 / EFA 4 ADM 5
«Με διάταγμα της 23ης του τρέχοντος Οκτωβρίου, διόρισα ως μέλη της εν λόγω Σχολής, τους κ.κ. Martha, Haussoullier και Beaudouin. Σύντομα θα λάβετε ένα αντίγραφο αυτού του διατάγματος. Αυτοί οι κύριοι έχουν λάβει απευθείας ειδοποίηση για τον διορισμό τους, κλήθηκαν παράλληλα να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις προετοιμασίες τους, ώστε να μπορέσουν να φύγουν μόλις τους παραδώσω τα δωρεάν διαβατήρια που ζήτησα γι΄αυτούς από τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών.»
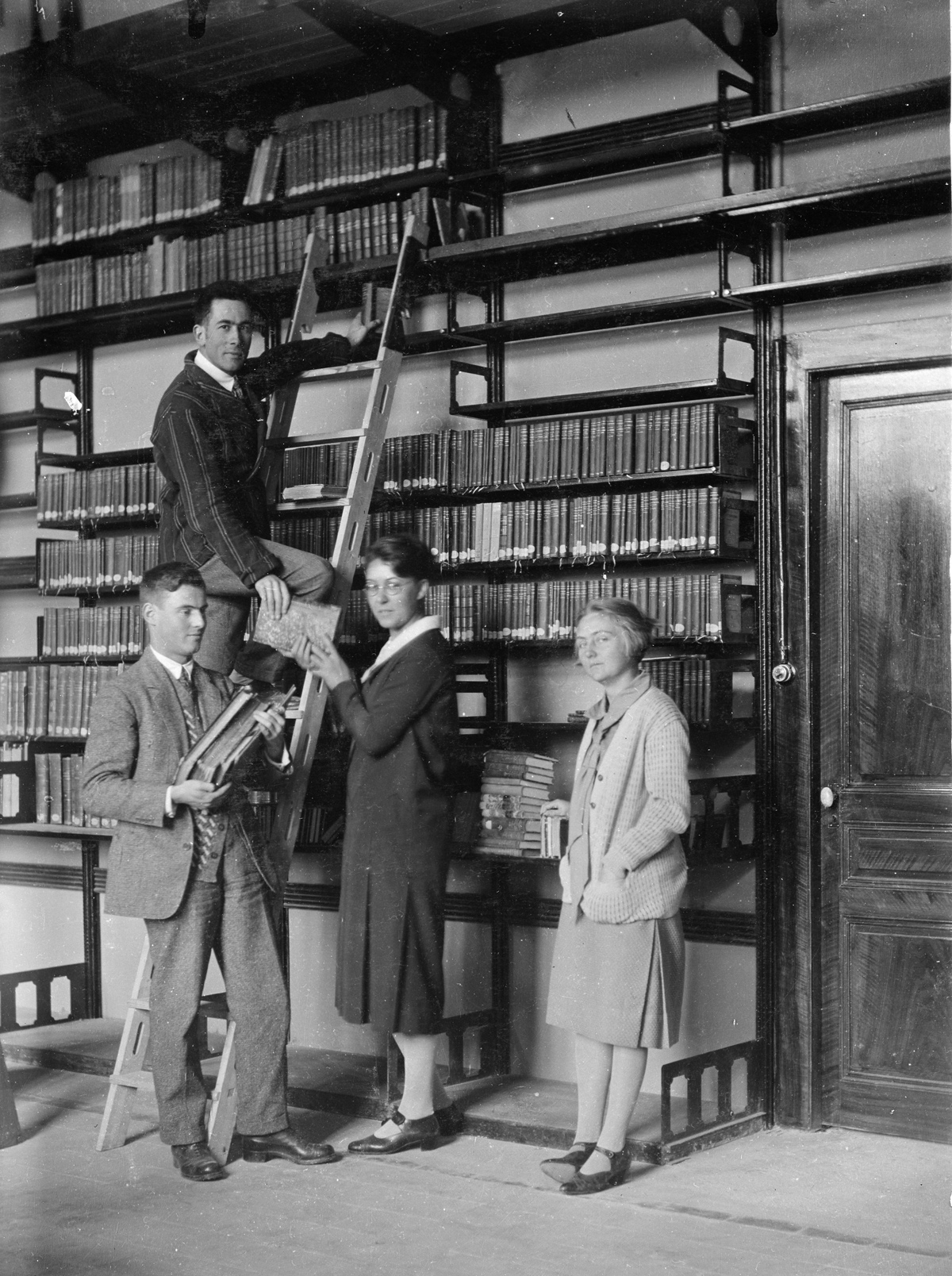 Devenir « membresse » à l’EFA …
« […] Depuis l’année 1926, des étrangères ont été admises à l’annexe de l’École avec le titre de membres. J’avais donné à leur admission un avis favorable que l’on a bien voulu suivre. Non seulement, il n’en est résulté aucune difficulté d’ordre intérieur, mais en un cas au moins, j’ai été amené à associer étroitement l’une de ces étrangères, une Hollandaise, aux travaux de l’École. Elle m’a rendu les plus précieux services par sa compétence en céramique. Dès lors, il me paraît équitable de permettre à des Françaises, elles-aussi, de manifester leurs aptitudes, sans restriction d’aucune sorte. Si, munies des mêmes titres que leurs camarades masculins, elles se montrent au concours spécial de l’École égales ou supérieures en connaissances, si leurs travaux antérieurs ont été appréciés favorablement, il me parait qu’elles ont droit à être nommées membres de l’École avec tous les avantages matériels en titre.[…] »
Extrait de la lettre de Pierre Roussel, directeur de l’École française d’Athènes, au directeur de l’Enseignement supérieur, 15 mars 1935.
Melle Van Leeuwen-Boomkamp, de nationalité hollandaise et membre étrangère de l’EFA en 1926-27, est la première « membresse » de l’École.
La première membre française, Nicole Weill, rejoindra l’EFA en 1956.
Devenir « membresse » à l’EFA …
« […] Depuis l’année 1926, des étrangères ont été admises à l’annexe de l’École avec le titre de membres. J’avais donné à leur admission un avis favorable que l’on a bien voulu suivre. Non seulement, il n’en est résulté aucune difficulté d’ordre intérieur, mais en un cas au moins, j’ai été amené à associer étroitement l’une de ces étrangères, une Hollandaise, aux travaux de l’École. Elle m’a rendu les plus précieux services par sa compétence en céramique. Dès lors, il me paraît équitable de permettre à des Françaises, elles-aussi, de manifester leurs aptitudes, sans restriction d’aucune sorte. Si, munies des mêmes titres que leurs camarades masculins, elles se montrent au concours spécial de l’École égales ou supérieures en connaissances, si leurs travaux antérieurs ont été appréciés favorablement, il me parait qu’elles ont droit à être nommées membres de l’École avec tous les avantages matériels en titre.[…] »
Extrait de la lettre de Pierre Roussel, directeur de l’École française d’Athènes, au directeur de l’Enseignement supérieur, 15 mars 1935.
Melle Van Leeuwen-Boomkamp, de nationalité hollandaise et membre étrangère de l’EFA en 1926-27, est la première « membresse » de l’École.
La première membre française, Nicole Weill, rejoindra l’EFA en 1956.
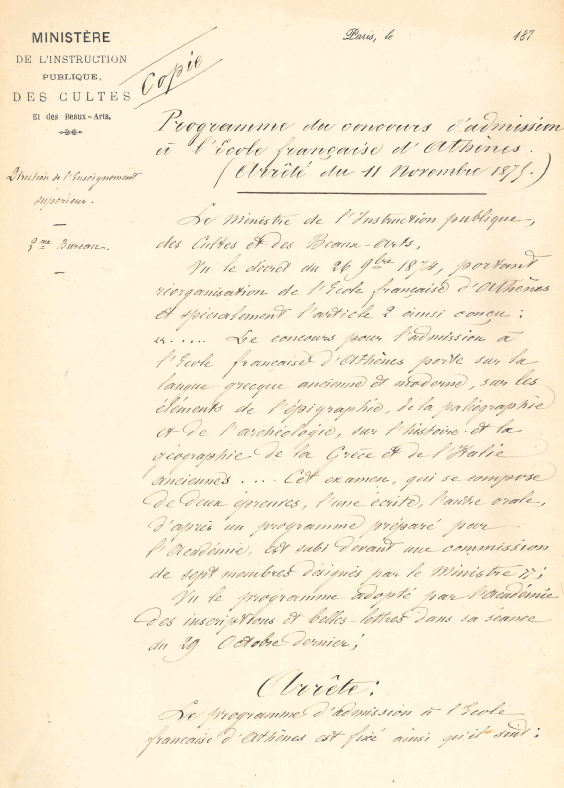 Passer le concours d’admission à l’École française d’Athènes en 1876 …
Sous la direction d’É. Burnouf, le décret du 26 septembre 1874, portant réorganisation de l’École, précise que l’examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale d’après un programme préparé par l’Académie. La commission chargée de faire passer les épreuves est composée de sept membres nommés par le Ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-arts.
Sous la direction d’A. Dumont, un arrêté du 11 novembre 1875 établit un programme détaillé, selon plusieurs sections : épigraphie grecque, épigraphie latine, paléographie, archéologie.
Un concours est ouvert en 1876, pour trois places vacantes. Un courrier officiel du Ministère fixe la date au 12 octobre à 8h30 pour l’épreuve écrite. L’enveloppe contenant le sujet de composition, sera décachetée devant les candidats.
Les membres de la promotion XXVII reçus à l’issue des épreuves de 1876, M. Beaudouin, B. Haussoullier et J. Martha, sont nommés par arrêté du 23 octobre. Tous trois sont élèves de l’École normale supérieure et agrégés de Lettres ou de Grammaire. Le même jour part un courrier ministériel à l’attention du directeur de l’EFA, précisant que les membres devront partir dès réception de leur passeport gratuit fourni par le Ministre des Affaires étrangères. MM. Haussoullier et Beaudouin passeront leur première année à l’École française de Rome, puis s’installeront pour deux années à Athènes. M. Martha inversera les deux séjours pour convenances personnelles.
Passer le concours d’admission à l’École française d’Athènes en 1876 …
Sous la direction d’É. Burnouf, le décret du 26 septembre 1874, portant réorganisation de l’École, précise que l’examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale d’après un programme préparé par l’Académie. La commission chargée de faire passer les épreuves est composée de sept membres nommés par le Ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-arts.
Sous la direction d’A. Dumont, un arrêté du 11 novembre 1875 établit un programme détaillé, selon plusieurs sections : épigraphie grecque, épigraphie latine, paléographie, archéologie.
Un concours est ouvert en 1876, pour trois places vacantes. Un courrier officiel du Ministère fixe la date au 12 octobre à 8h30 pour l’épreuve écrite. L’enveloppe contenant le sujet de composition, sera décachetée devant les candidats.
Les membres de la promotion XXVII reçus à l’issue des épreuves de 1876, M. Beaudouin, B. Haussoullier et J. Martha, sont nommés par arrêté du 23 octobre. Tous trois sont élèves de l’École normale supérieure et agrégés de Lettres ou de Grammaire. Le même jour part un courrier ministériel à l’attention du directeur de l’EFA, précisant que les membres devront partir dès réception de leur passeport gratuit fourni par le Ministre des Affaires étrangères. MM. Haussoullier et Beaudouin passeront leur première année à l’École française de Rome, puis s’installeront pour deux années à Athènes. M. Martha inversera les deux séjours pour convenances personnelles.
Michel Sève, ancien membre (1975-1979). Souvenirs de 1975.
« Le concours comportait une manière d’écrit, la présentation d’un mémoire d’archéologie, d’épigraphie ou d’histoire (à l’époque, il ne pouvait s’agir que du mémoire de maîtrise ; je ne me rappelle pas qu’aucun de mes camarades ou concurrents ait présenté autre chose) ; il fallait en fournir un exemplaire plusieurs semaines avant l’oral proprement dit, pour qu’il puisse circuler entre les membres du jury. Le concours se tenait, depuis peu, au mois de juin ; antérieurement, c’était en octobre. Il comportait alors cinq épreuves, presque toutes techniques : l’épigraphie dont se chargeait Louis Robert qui présidait le jury ; l’architecture, domaine de Roland Martin ; la sculpture, pour Pierre Demargne ; Pierre Devambez s’occupait de la céramique, et Robert Flacelière de l’improvisée de grec (ancien, il va de soi), suivie d’une interrogation d’histoire en rapport avec le texte. Le directeur Pierre Amandry complétait le jury et intervenait sur beaucoup de sujets, mais surtout la sculpture (il m’en a présenté une qui allait paraître dans la Chronique et était encore inédite). Tous étaient membres de l’Institut, sauf Roland Martin qui devait le devenir cette même année. L’oral se déroulait sur deux jours, au Collège de France, et les choses étaient artisanales : l’inscription était copiée de sa main par Louis Robert, de même que le texte grec proposé par Robert Flacelière ; ce dernier avait commis une faute de copie qu’il est venu corriger pendant mon temps de préparation, mais je m’en étais aperçu et l’avais rectifiée, ce dont il s’était presque étonné (et vexé ?). Pierre Devambez interrogeait sur des tessons empruntés à François Villard qu’il faisait circuler, Roland Martin, plus moderne, apportait un tirage des photos du sujet pour chacun. Le cadre avait tout pour impressionner : la salle où il se passait était toute en longueur, avec une immense table de bois ; le jury était en rang d’oignons d‘un côté, le candidat de l’autre. Louis Robert tenait à ce que la porte reste ouverte, au motif que le concours était public. Ce n’était pas un vain mot. Quand je suis passé en céramique, un jeune auditeur était entré, et Louis Robert l’a fait remarquer à tous : « Devambez, fais passer les tessons à notre auditeur, qu’il les voie lui aussi ». Sans cela, je n’en aurais rien su. »